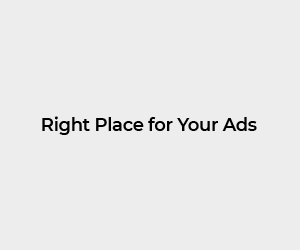Une analyse des indicateurs économiques de la Chine à la fin de 2025 révèle une économie profondément scindée, caractérisée par une vigueur tirée par l’État dans les secteurs d’exportation de haute technologie et une fragilité systémique de sa demande intérieure. Bien que la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) réel au troisième trimestre (T3) 2025, à 4,8 % en glissement annuel 1, maintienne le pays sur la bonne voie pour atteindre son objectif officiel d’« environ 5 % », ce chiffre global masque des faiblesses sous-jacentes critiques.
- Le paysage macroéconomique de 2025 : Une reprise inégale et déflationniste
- A. Analyse de la croissance du PIB au T3 2025 : Au-delà du chiffre officiel
- B. Le signal d’alarme déflationniste : Le PIB nominal face au PIB réel
- C. L’IPC et l’inflation à la consommation : Piégés en territoire négatif
- D. Le marché du travail : Stabilité apparente, tension sous-jacente
- L’effondrement de la demande intérieure : Le consommateur absent et l’investissement faussé
- A. L’échec de la consommation comme moteur de croissance
- B. Investissement en actifs fixes (FAI) : Une histoire de deux secteurs
- La crise immobilière : De la crise de liquidité à la solvabilité systémique
- A. L’aggravation de la chute : Chiffres de 2025
- B. Le point d’inflexion : Le cas de China Vanke
- C. L’inefficacité de la réponse politique
- La nouvelle stratégie industrielle de la Chine : Les « Nouvelles forces productives » comme seul moteur
- A. De « Made in China 2025 » à la nouvelle stratégie
- B. Les preuves du succès tiré par l’offre
- C. La prochaine frontière : « AI plus Manufacturing »
- D. Le paradoxe de la surcapacité déflationniste
- La position mondiale de la Chine : Excédent commercial et frictions croissantes
- A. L’excédent commercial comme soupape de sécurité économique
- B. Reconfiguration des partenaires commerciaux : L’ascension de l’ASEAN
- C. La réaction occidentale : Droits de douane et « de-risking »
- D. La trêve commerciale de novembre 2025 (Trump-Xi) : Une pause tactique
- Démêler la « bombe de la dette » de la Chine : LGFV et risque systémique
- A. L’ampleur du problème de la dette
- B. Le cœur du problème : La dette cachée des LGFV
- C. La réponse de Pékin : « Étendre et prétendre »
- D. Risque systémique et avertissements du FMI
- Flux de capitaux et le paradoxe de l’investissement direct étranger (IDE)
- A. Le discours officiel contre la réalité de la balance des paiements
- B. Le climat d’investissement : « Anxiété » et « Restrictions »
- C. L’impact du « De-risking » sur les chaînes d’approvisionnement
- La réponse politique de Pékin : Miser sur l’offre, pas sur la demande
- A. Politique monétaire : Paquet de 10 points et taux administrés
- B. Politique budgétaire : Le gouvernement central prend le contrôle
- C. Le déséquilibre critique de la politique
- Perspectives 2026 et conclusions stratégiques
Le signal d’alarme le plus significatif est l’écart entre la croissance du PIB réel (4,8 %) et la croissance du PIB nominal (seulement 3,7 %).1 Cet écart confirme la présence de pressions déflationnistes dans l’ensemble de l’économie, un symptôme de la faiblesse grave de la demande, du pouvoir de fixation des prix et de la rentabilité des entreprises.
La thèse centrale de ce rapport est que la Chine opère une économie à deux vitesses :
- Moteur rapide (tiré par l’offre) : Une expansion robuste de la fabrication de haute technologie 1 et un excédent commercial croissant 4, alimentés par la politique industrielle phare des « Nouvelles forces productives ».6
- Moteur lent (demande intérieure) : Un effondrement de la demande intérieure, mis en évidence par une crise du secteur immobilier qui s’éternise 7, une consommation de détail faible et en décélération 9, et une confiance des consommateurs durablement basse.10
La stratégie de Pékin visant à compenser cette faiblesse interne par la surproduction industrielle exporte ses déséquilibres. Cela se manifeste par un excédent commercial record 5 et provoque des frictions commerciales directes avec les États-Unis et l’Union européenne, qui ont réagi par des droits de douane significatifs.11
Les principaux risques systémiques comprennent une crise de solvabilité dans le secteur immobilier, qui touche désormais des promoteurs soutenus par l’État comme Vanke 13 ; la « dette cachée » insoutenable des gouvernements locaux (LGFV) 14 ; et une fuite de capitaux historique des entreprises étrangères, visible dans les données de la balance des paiements.15 La réponse politique de Pékin a été asymétrique, favorisant massivement l’offre et l’investissement au détriment de la demande des consommateurs.16 Les perspectives pour 2026 indiquent un ralentissement continu, avec des risques significatifs d’un scénario de « japonisation ».18
Le paysage macroéconomique de 2025 : Une reprise inégale et déflationniste
Cette section établit le panorama macroéconomique de référence, en utilisant les données du T3 2025 pour introduire le récit central de la déflation et de la croissance déséquilibrée.
A. Analyse de la croissance du PIB au T3 2025 : Au-delà du chiffre officiel
Les données officielles du T3 2025 montrent que l’économie chinoise a progressé de 4,8 % en glissement annuel.1 Bien qu’il s’agisse du rythme le plus faible depuis un an, il correspond à l’objectif de croissance annuel du gouvernement d’« environ 5 % ».1 D’un trimestre à l’autre, l’économie a progressé de 1,1 % 19, dépassant les attentes du marché de 0,8 %.2 Au cours des trois premiers trimestres de 2025, le PIB cumulé a augmenté de 5,2 % en glissement annuel, atteignant 101 500 milliards de RMB.1
Bien que ces chiffres globaux semblent stables, la composition de cette croissance révèle les premiers signes de déséquilibre. La croissance est soutenue presque entièrement par la « fabrication/exportations de haute technologie et un excédent commercial croissant », tandis que la « demande intérieure est faible » et le « ralentissement du secteur immobilier continue de peser sur les dépenses et l’investissement ».1
B. Le signal d’alarme déflationniste : Le PIB nominal face au PIB réel
La preuve la plus flagrante de la faiblesse de la demande intérieure se trouve dans l’écart entre le PIB nominal et le PIB réel. Alors que le PIB réel (corrigé de l’inflation) a augmenté de 4,8 %, le PIB nominal (en prix courants) n’a progressé que de 3,7 % en glissement annuel au T3.1
Cet écart de 1,1 point de pourcentage implique que le déflateur du PIB, la mesure de l’inflation la plus large de l’économie, a été négatif d’environ 1,1 %. C’est un signe clair de déflation à l’échelle de l’économie, plus grave que celle indiquée par l’Indice des Prix à la Consommation (IPC). Cette déflation indique un « faible pouvoir de fixation des prix » et exerce une « pression » immense sur les « bénéfices des entreprises, les salaires et les recettes fiscales ».1 Dans un pays où le fardeau total de la dette est l’un des plus élevés au monde 14, la baisse des prix augmente le fardeau réel de la dette existante, décourage les nouveaux investissements privés et augmente le risque d’une spirale de « japonisation ».18
C. L’IPC et l’inflation à la consommation : Piégés en territoire négatif
Les pressions déflationnistes du côté de la demande sont confirmées par l’IPC. L’IPC de septembre 2025 a enregistré une baisse de 0,3 % en glissement annuel 20, après une baisse de 0,4 % en août.21 C’est le deuxième mois consécutif de déflation des prix à la consommation.21
La baisse est largement due à l’inflation des produits alimentaires (-4,4 % en septembre) 20 et à la chute des prix des transports (-2,4 % en glissement annuel).22 Cependant, l’IPC sous-jacent (qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie) est dangereusement faible, avec une augmentation de seulement 0,6 %.1 Ce chiffre très bas, bien en deçà de tout objectif d’inflation sain, souligne l’absence de demande fondamentale de la part des consommateurs.
D. Le marché du travail : Stabilité apparente, tension sous-jacente
En surface, le marché du travail semble stable. Le taux de chômage urbain recensé au niveau national est tombé à 5,2 % en septembre, contre 5,3 % en août.23 Il se maintient confortablement dans l’objectif officiel du gouvernement d’« environ 5,5 % » pour 2025.25 Au cours des neuf premiers mois de l’année, la Chine a créé 10,57 millions de nouveaux emplois urbains, atteignant 88 % de l’objectif annuel de 12 millions.24
Cependant, cette stabilité cache un bouleversement structurel. L’effondrement du secteur immobilier, à forte intensité de main-d’œuvre, a déplacé des millions de personnes, tandis que l’essor de la fabrication de haute technologie nécessite un ensemble de compétences différent. Le taux de chômage des travailleurs migrants (une part essentielle de la main-d’œuvre industrielle) était de 4,9 % 23, inférieur à la moyenne nationale, ce qui suggère que le secteur manufacturier absorbe de la main-d’œuvre. Néanmoins, les « heures de travail hebdomadaires moyennes » de 48,6 heures 23 suggèrent que les entreprises maximisent la productivité des employés existants plutôt que de procéder à des embauches massives, dans un contexte de marges bénéficiaires réduites par la déflation.
Tableau 1 : Principaux indicateurs économiques de la Chine (T3 2025)
| Indicateur | Données du T3 2025 (Glissement annuel) | Données YTD (T1-T3 2025) | Source(s) |
| Croissance du PIB réel | 4,8 % | 5,2 % | 1 |
| Croissance du PIB nominal | 3,7 % | N/A | 1 |
| Taux d’inflation (IPC, Sep) | -0,3 % | -0,1 % | [1, 20] |
| Taux d’inflation sous-jacente (Sep) | 0,6 % | N/A | [1, 20] |
| Taux de chômage urbain (Sep) | 5,2 % (Taux) | 5,2 % (Moyenne) | 23 |
| Croissance de la production industrielle (Sep) | 6,5 % | 6,2 % | 3 |
| Croissance des ventes au détail (Sep) | 3,0 % | 4,5 % | [1, 9] |
| Excédent commercial (YTD, Sep) | N/A | 875,1 Mds $ | 5 |
L’effondrement de la demande intérieure : Le consommateur absent et l’investissement faussé
La faiblesse déflationniste de l’économie chinoise provient du « moteur lent » de la demande intérieure. Un consommateur craintif et un changement tectonique dans l’investissement ont laissé un vide que la politique industrielle à elle seule ne peut combler.
A. L’échec de la consommation comme moteur de croissance
Bien que les ventes au détail totales aient augmenté de 4,5 % au cours des trois premiers trimestres de 2025 1, la tendance est alarmante. La croissance interannuelle des ventes au détail a ralenti consécutivement, n’atteignant que 3,0 % en septembre 2, le « plus faible [niveau] depuis août 2024 ».9 Cela fait suite à 3,4 % en août 27 et 3,7 % en juillet.9
La racine de cette faiblesse est un « effet de richesse négatif » découlant directement de l’effondrement du secteur immobilier. L’immobilier représentant la majeure partie de la richesse des ménages chinois 7, la chute des prix du logement a donné aux consommateurs le sentiment de s’appauvrir. Ceci, combiné à l’incertitude du marché du travail et à la stagnation des salaires (implicite dans la faible croissance du PIB nominal de 3,7 % 1), a renforcé une mentalité d’épargne de précaution.28
La confiance des consommateurs reste bloquée près de ses plus bas historiques. L’indice s’établissait à 89,2 en août 2025, bien en deçà de sa moyenne historique de 108,86.10 Dans cet environnement, les mesures de relance gouvernementales, telles que les « programmes d’échange » d’appareils électroménagers et d’automobiles 30, montrent un effet « décroissant ».30 Sans une restauration fondamentale de la confiance, le consommateur chinois ne sera pas le moteur de croissance dont Pékin a besoin.18
B. Investissement en actifs fixes (FAI) : Une histoire de deux secteurs
L’investissement en actifs fixes (FAI) expose la divergence flagrante au sein de l’économie. Le chiffre global montre une contraction de 0,5 % au cours des neuf premiers mois de 2025.1 Cependant, ce chiffre cache une histoire dramatique d’allocation de capital dirigée par l’État.
L’analyse des composantes révèle deux économies distinctes :
- L’économie de marché (en plein effondrement) : L’investissement dans le secteur immobilier s’est effondré de 13,9 %.8 Cela a entraîné l’ensemble de l’industrie tertiaire (services), qui s’est contractée de 4,3 %.1 Cette contraction du secteur des services, orienté vers le consommateur et l’emploi, est un signal d’alarme d’une profonde faiblesse de la demande privée.
- L’économie dirigée (en plein essor) : Si l’on exclut le secteur immobilier, le FAI a en fait augmenté de 3,0 %.1 Cette croissance a été massivement canalisée vers l’industrie secondaire (industrie), qui a vu ses investissements augmenter de 6,3 %.1 Au sein de celle-ci, l’investissement dans le secteur manufacturier a augmenté de 4,0 %.1
Pékin utilise les leviers étatiques (prêts bancaires, subventions) pour forcer l’investissement dans le secteur manufacturier 33 et compenser le trou de 13,9 points de pourcentage laissé par le secteur immobilier. Cette stratégie garantit la surcapacité. L’économie intérieure, avec un investissement dans les services en contraction (-4,3 %) et des ventes au détail faibles (+3,0 %), ne peut absorber la production d’un investissement manufacturier en plein essor. Le seul débouché pour cette production est l’exportation, ce qui lie directement la politique d’investissement intérieure de la Chine à ses conflits commerciaux extérieurs.
Tableau 2 : Répartition de l’investissement en actifs fixes (YTD Sep 2025)
| Secteur d’investissement | Croissance YTD (Glissement annuel, Jan-Sep 2025) | Source(s) |
| FAI Total | -0,5 % | 1 |
| FAI (hors immobilier) | +3,0 % | 1 |
| Par industrie principale : | ||
| Industrie primaire | +4,6 % | 1 |
| Industrie secondaire (Industrie) | +6,3 % | 1 |
| Industrie tertiaire (Services) | -4,3 % | 1 |
| Par secteur clé : | ||
| Investissement dans la promotion immobilière | -13,9 % | 8 |
| Investissement manufacturier | +4,0 % | [1, 34] |
| Manufacturier (Jan-Aoû 2025) : | ||
| Automobiles | +20,2 % | [35] |
| Ferroviaire, naval, aérospatial | +26,2 % | [35] |
| Ordinateurs et équipements électroniques | -0,1 % | [35] |
La crise immobilière : De la crise de liquidité à la solvabilité systémique
La crise immobilière est entrée dans une phase nouvelle et plus dangereuse. Ce qui a commencé comme un problème de liquidité pour les promoteurs privés s’est transformé en une crise de solvabilité systémique qui brise les garanties étatiques implicites et paralyse la demande intérieure.
A. L’aggravation de la chute : Chiffres de 2025
Le secteur ne montre aucun signe de redressement.36 L’investissement dans la promotion immobilière s’est contracté de 13,9 % en glissement annuel au cours des neuf premiers mois de 2025.8 Les ventes de logements neufs devraient chuter de 15 % en 2025, et les prix des logements ont diminué de près de 10 % depuis début 2024.7 Les fonds disponibles pour les promoteurs ont chuté de 7,5 % au cours des sept premiers mois de l’année.37 La crise, déclenchée par la politique des « trois lignes rouges » en 2020, a décimé un secteur qui contribuait autrefois jusqu’à 25 % du PIB de la Chine.7
B. Le point d’inflexion : Le cas de China Vanke
Les défauts sur la dette en dollars ont dépassé les 130 milliards 38, conduisant à la liquidation ou à une restructuration profonde de géants privés comme Evergrande 39 et Country Garden.40 Cependant, l’événement le plus sismique de 2025 a été l’effondrement de la confiance dans les promoteurs hybrides (partiellement publics).
Le 5 novembre 2025, S&P Global Ratings a abaissé la note de China Vanke, un promoteur avec un actionnaire public important (Shenzhen Metro), à ‘CCC’ avec perspective négative.13 Cette note de « junk bond » profond reflète l’opinion de S&P selon laquelle les « engagements financiers [de Vanke] semblent insoutenables » et qu’il « pourrait faire défaut sur ses obligations de dette ».13
Cet événement est crucial car il brise la « garantie implicite » de l’État. Le marché supposait que Vanke était « sûr » en raison de son soutien public. L’abaissement de la note démontre que le soutien de l’État est sélectif, et non inconditionnel. Cela explique pourquoi les créanciers internationaux d’autres promoteurs sont devenus « plus discrets » dans les négociations et sont « prêts à accepter des décotes (haircuts) plus importantes » 38 ; ils ont réalisé qu’aucun sauvetage global n’interviendrait. La crise est passée d’un problème de liquidité des promoteurs privés à un problème de solvabilité de l’ensemble du secteur.
C. L’inefficacité de la réponse politique
La réponse politique de Pékin a été remarquablement timide. Le taux de référence pour la plupart des prêts hypothécaires, le Taux préférentiel de prêt (LPR) à 5 ans, n’a été réduit que de 10 points de base jusqu’à présent en 2025, contrastant fortement avec les 60 points de base de réduction en 2024.36 L’assouplissement des restrictions à l’achat de logements dans les villes de premier rang comme Pékin et Shanghai en août n’a été que « partiel » et s’est largement concentré sur les banlieues.36
Pékin est pris au piège. Une relance massive (baisses de taux importantes, sauvetages) pourrait accélérer la fuite des capitaux 15, détruire les marges bénéficiaires des banques (déjà affaiblies, selon le FMI 41) et regonfler une bulle qu’ils essaient de dégonfler. S’ils ne font rien, l’implosion de la confiance 42 et l’effondrement des dépenses de consommation 9 entraîneront toute l’économie. Ils ont choisi une voie médiane : « gérer l’effondrement » plutôt que « concevoir une reprise », confirmant que les dirigeants ont abandonné le secteur immobilier comme moteur de croissance.
La nouvelle stratégie industrielle de la Chine : Les « Nouvelles forces productives » comme seul moteur
Le modèle immobilier étant brisé, la Chine a misé son avenir économique sur un nouveau moteur : une stratégie industrielle massive connue sous le nom de « Nouvelles forces productives ». Il ne s’agit pas d’une simple politique, mais du nouveau modèle de croissance économique du pays, conçu pour compenser l’effondrement de l’immobilier et propulser la Chine dans la chaîne de valeur mondiale.
A. De « Made in China 2025 » à la nouvelle stratégie
La tristement célèbre politique « Made in China 2025 » (lancée en 2015 43) a disparu du discours public vers 2018 en raison d’intenses critiques internationales.44 Cependant, ses objectifs centraux ont continué et évolué sous de nouvelles bannières, telles que « Nouvelles forces productives ».6 Cette nouvelle itération met l’accent sur l’industrie « intelligente, verte et de haute qualité » 6, en se concentrant sur des secteurs tels que les véhicules électriques (VE), les panneaux solaires, les batteries, la robotique, l’intelligence artificielle (IA) et la biotechnologie.6 La stratégie est alimentée par d’énormes financements publics via des fonds d’orientation, des prêts bancaires dirigés et des subventions.46
B. Les preuves du succès tiré par l’offre
Les résultats de cet investissement massif du côté de l’offre sont évidents dans les données de production de 2025. La production industrielle globale a augmenté de 6,5 % en glissement annuel en septembre, dépassant de loin les prévisions du marché de 5,0 %.2 Le PMI manufacturier s’est établi à 49,8, presque stable.1
La croissance a été explosive dans les secteurs ciblés par les « Nouvelles forces productives ». En septembre 2025, la croissance de la production en glissement annuel était de :
- Construction automobile : +16,0 % 3
- Équipements informatiques et de communication : +11,3 % 3
- Équipements ferroviaires, navals et aérospatiaux : +10,3 % 3
La domination physique de la Chine dans ces domaines est désormais incontestable. Au cours des neuf premiers mois de 2025, la Chine a installé 595 000 bras robotisés industriels.49 De manière stupéfiante, la Chine exploite désormais plus de robots industriels que le reste du monde combiné et a représenté plus de la moitié de toutes les nouvelles installations mondiales de robots en 2024.49
C. La prochaine frontière : « AI plus Manufacturing »
Pékin redouble d’efforts dans cette stratégie. En novembre 2025, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) a annoncé un nouveau plan « AI plus Manufacturing ».50 L’objectif est d’intégrer profondément l’IA dans l’économie industrielle chinoise 50, en mettant l’accent sur la transformation intelligente des industries clés et des processus de production critiques.50 Le plan de Shanghai (2025-2027) sert de modèle, cherchant à intégrer l’IA dans 3 000 entreprises manufacturières locales.51 La Chine compte déjà plus de 5 000 entreprises d’IA 50 qui soutiennent cette dynamique.
D. Le paradoxe de la surcapacité déflationniste
Cet essor de la production industrielle coexiste avec la « faible demande intérieure » et la déflation du PIB discutées précédemment.1 Les rapports d’enquêtes auprès des entreprises montrent qu’elles sont aux prises avec de « faibles commandes intérieures ».1 Cela signifie que la nouvelle capacité de production, financée par l’État, crée des biens que les consommateurs et les entreprises nationaux ne peuvent ou ne veulent pas acheter.
Pour éviter la faillite et maintenir les usines en activité, ces entreprises doivent vendre à l’étranger. Cela a été qualifié de « Second Choc Chinois ».52 Le modèle de croissance des « Nouvelles forces productives » n’est pas seulement une stratégie de développement ; c’est un modèle qui nécessite d’exporter la surcapacité et la déflation vers le reste du monde.53 Cela rend le conflit commercial structurel et inévitable.
La position mondiale de la Chine : Excédent commercial et frictions croissantes
La stratégie économique intérieure de la Chine a des répercussions directes et déstabilisatrices sur les marchés mondiaux. L’excédent commercial est devenu la soupape de sécurité essentielle à la faiblesse de la demande intérieure, exacerbant les tensions géopolitiques.
A. L’excédent commercial comme soupape de sécurité économique
L’excédent commercial de la Chine a atteint des niveaux records. En septembre 2025, la Chine a enregistré un excédent de 90,45 milliards de dollars.5 L’excédent total cumulé depuis le début de l’année (YTD) jusqu’en septembre a atteint 875,1 milliards de dollars.5
La cause de cet excédent massif est une divergence commerciale qui reflète parfaitement l’économie à deux vitesses du pays :
- Exportations (tirées par l’offre) : Au cours des neuf premiers mois de 2025, les exportations ont augmenté de 6,1 % en glissement annuel.5 Cette croissance est tirée par la fabrication de haute technologie 1 et les produits électriques.54
- Importations (reflet de la demande) : Sur la même période, les importations ont chuté de 1,1 % en glissement annuel.5
Cet écart 53 est la preuve la plus claire du déséquilibre de la Chine. La faiblesse des importations est un indicateur de l’effondrement de la demande intérieure (immobilier, consommation).55 La vigueur des exportations est le résultat direct de la surproduction des « Nouvelles forces productives ».3 La Chine utilise le reste du monde comme consommateur de dernier recours et, ce faisant, exporte ses pressions déflationnistes.53
B. Reconfiguration des partenaires commerciaux : L’ascension de l’ASEAN
En réponse aux tensions commerciales avec l’Occident, la Chine a réorienté avec succès ses flux commerciaux. L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a consolidé sa position de premier partenaire commercial de la Chine 54, un titre qu’elle détient depuis 2020.56 En août 2025, par exemple, les exportations vers l’ASEAN ont dépassé 57 milliards de dollars, éclipsant les exportations vers les États-Unis, qui ont chuté à 31,6 milliards.58 La signature du Protocole de mise à niveau 3.0 de l’ALE Chine-ASEAN en octobre 2025 approfondit encore cette relation.56
Cependant, cette relation n’est pas sans frictions. La pratique du « lavage d’origine » (transbordement de produits chinois via les pays de l’ASEAN pour échapper aux droits de douane américains) est une préoccupation croissante.59 De plus, l’afflux de produits chinois à bas prix, alimenté par la surcapacité industrielle, a forcé la fermeture de milliers d’usines locales dans des pays comme la Thaïlande et l’Indonésie.59
C. La réaction occidentale : Droits de douane et « de-risking »
Les économies occidentales réagissent agressivement à la politique industrielle de la Chine. Voyant l’avalanche d’exportations de technologies vertes non pas comme une concurrence loyale, mais comme un « événement de niveau extinction » 60 alimenté par des subventions publiques 61, elles ont érigé des barrières commerciales :
- États-Unis : Ont imposé un droit de douane prohibitif de 100 % sur les VE chinois.12 Le tarif moyen sur tous les produits chinois s’élevait à 57,6 % en septembre 2025.11
- Union européenne : A imposé des droits de douane provisoires sur les VE chinois allant de 27,4 % à 48,1 %.12
Ces droits de douane ne sont pas du protectionnisme standard ; ils constituent une réponse défensive directe à la stratégie des « Nouvelles forces productives » de la Chine. Cela crée un dilemme fondamental : le nouveau modèle économique de la Chine nécessite un excédent commercial massif pour réussir, mais ce même excédent provoque une réaction protectionniste qui menace de fermer ses marchés d’exportation les plus lucratifs.62
D. La trêve commerciale de novembre 2025 (Trump-Xi) : Une pause tactique
Sur fond d’escalade des tensions, y compris la menace de la Chine d’« étrangler » les chaînes d’approvisionnement avec des contrôles à l’exportation de terres rares 52, une « trêve » temporaire a été conclue lors du sommet de fin octobre/début novembre 2025.52
- Actions des États-Unis : Ont accepté de réduire les droits de douane « liés au fentanyl » de 10 points de pourcentage et de suspendre pour un an les actions de la Section 301 sur la construction navale.64
- Actions de la Chine : A accepté de suspendre ses contrôles à l’exportation de terres rares annoncés le 9 octobre 64, de suspendre les droits de douane de rétorsion et de reprendre les achats de soja américain.65
Cet accord n’est pas une résolution de « Phase Deux ».69 C’est une désescalade tactique pour ramener les deux parties en deçà du précipice. Les problèmes structurels — les droits de douane centraux de la Section 301, les droits de 100 % sur les VE 12 et la guerre technologique des semi-conducteurs 52 — restent non résolus. C’est une trêve fragile, pas une réinitialisation.69
Démêler la « bombe de la dette » de la Chine : LGFV et risque systémique
La faiblesse de la demande intérieure de la Chine et la nature forcée de son virage industriel sont intrinsèquement liées à sa crise de la dette, en particulier à la « dette cachée » de ses gouvernements locaux.
A. L’ampleur du problème de la dette
La dette totale non financière de la Chine dépasse 300 % du PIB.14 Cependant, la véritable préoccupation réside dans la dette publique. Les données du FMI d’octobre 2025 situent la dette publique globale de la Chine à 96,3 % du PIB.70 Mais ce chiffre officiel est trompeur. Le FMI lui-même utilise une définition « élargie » qui inclut les « obligations locales hors bilan », estimant le chiffre réel à 124 % du PIB.14
Cet écart de près de 30 points de PIB est la crise. Il représente la « dette cachée » accumulée par des milliers de véhicules de financement des gouvernements locaux (LGFV).
B. Le cœur du problème : La dette cachée des LGFV
Les LGFV sont la « source centrale de tension ».14 Ce sont des entités hors bilan créées par les gouvernements locaux (dont les sources de recettes fiscales ont été centralisées en 1994 72) pour financer la construction d’infrastructures. Ils l’ont fait en empruntant massivement auprès des banques et des marchés obligataires, en utilisant les revenus croissants de la vente de terrains comme garantie.72
L’effondrement du secteur immobilier (Section III) a brisé ce modèle économique. La « forte baisse des revenus de la vente de terrains depuis 2022 » 14 a coupé la principale source de revenus des LGFV, les laissant sans flux de trésorerie pour payer leurs dettes. Désormais, ils dépendent de la « tolérance bancaire » (c’est-à-dire le refinancement des prêts non performants) pour survivre.14 Cela a créé une « récession de bilan » 14, où les gouvernements locaux sont fiscalement paralysés, incapables de fournir des services sociaux ou de stimuler la consommation.73 La dette des LGFV est la courroie de transmission qui relie l’effondrement de l’immobilier à la faiblesse de la consommation.
C. La réponse de Pékin : « Étendre et prétendre »
La réponse de Pékin n’a pas été un sauvetage, mais une restructuration forcée que les analystes ont qualifiée d’« étendre et prétendre » (extend and pretend).73 Cette stratégie implique :
- D’« échanger » la dette LGFV opaque et hors bilan contre des obligations de refinancement provinciales au bilan, qui ont des échéances plus longues et des taux d’intérêt plus bas.14
- De mobiliser les banques d’État pour fournir 1 000 milliards de yuans de prêts afin d’aider les LGFV à épurer les arriérés de paiement aux entreprises privées.74
- D’allonger les échéances et de permettre les « renouvellements » (rollovers).14
Cette stratégie a stabilisé les marchés de financement à court terme, mais elle ne résout pas le problème de solvabilité sous-jacent. Elle ne fait que transférer la dette « cachée » vers le bilan souverain « visible » 14, repoussant le problème à plus tard.14
D. Risque systémique et avertissements du FMI
Cette tactique d’« étendre et prétendre » crée un risque systémique pour le secteur bancaire. Le FMI, dans son Évaluation de la stabilité du système financier (FSSA) de 2025, a averti que la « politique monétaire accommodante affaiblit la rentabilité organique des banques » et que les « petites banques… sont plus vulnérables ».41
La Banque populaire de Chine (PBOC) est piégée. Elle doit maintenir les taux d’intérêt bas pour permettre aux LGFV et aux promoteurs immobiliers de refinancer leur dette sans s’effondrer. Mais ces taux bas compriment les marges nettes d’intérêt (MNI) des banques, évaporant leurs bénéfices. Les petites banques, qui sont les plus exposées aux LGFV et aux promoteurs immobiliers en faillite, risquent l’insolvabilité.41 Le FMI a conclu que le « cadre actuel de gestion de crise ne soutient pas adéquatement » une « détresse systémique ».41 Ce piège bancaire explique la timidité de la politique monétaire de Pékin.36
Flux de capitaux et le paradoxe de l’investissement direct étranger (IDE)
La confiance des investisseurs mondiaux en Chine s’est considérablement érodée, un fait obscurci par un paradoxe dans les données sur l’investissement étranger.
A. Le discours officiel contre la réalité de la balance des paiements
Le gouvernement chinois promeut un discours de succès, citant des « gains difficilement acquis ».75 Le ministère du Commerce (MOFCOM) rapporte que l’IDE « utilisé » (une mesure des entrées brutes) a atteint 708,73 milliards de dollars depuis 2021, atteignant l’objectif du 14e Plan quinquennal avec six mois d’avance.75 Ils soulignent également la croissance de l’investissement dans les secteurs de haute technologie.75
Cependant, les données de la balance des paiements (BdP), qui mesurent les flux nets (entrées moins sorties), brossent un tableau complètement différent. Les entrées nettes d’IDE se sont effondrées :
- 2021 (Pic) : +344 milliards de dollars
- 2023 : +42,7 milliards de dollars (le niveau le plus bas en deux décennies)
- S1 2024 : -4,6 milliards de dollars (Négatif pour la première fois) 15
Ces deux ensembles de données ne sont pas contradictoires ; ils mesurent des choses différentes. L’IDE « utilisé » (brut) 75 mesure les nouveaux investissements. L’IDE net (BdP) 15 mesure les nouveaux investissements moins les sorties, qui incluent le rapatriement des bénéfices des entreprises étrangères existantes.15
La seule façon pour que les entrées nettes soient négatives alors que les entrées brutes sont positives est que les entreprises étrangères existantes retirent leurs bénéfices de Chine à un rythme plus rapide que l’entrée de nouveaux capitaux. Ce n’est pas du « de-risking » ; c’est une fuite de capitaux. C’est le signal le plus fort possible d’une perte de confiance des multinationales.15
Tableau 3 : Divergence des flux d’investissement étranger (2021-2024)
| Période | IDE « utilisé » (Brut, Cumulé depuis 2021) | IDE Net (Balance des paiements, Flux de la période) | Source(s) |
| 2021 | N/A | +344 Mds $ | 15 |
| 2023 | N/A | +42,7 Mds $ | 15 |
| S1 2024 | N/A | -4,6 Mds $ | 15 |
| À Juin 2025 | +708,73 Mds $ (Objectif du Plan Quinquennal) | N/A | 75 |
B. Le climat d’investissement : « Anxiété » et « Restrictions »
Cette fuite de capitaux est due à un climat d’investissement qui se détériore rapidement. L’investissement étranger total en Chine a chuté de 27,1 % en 2024, la baisse la plus marquée depuis 2008.76 Le département d’État américain, dans son rapport de 2025, qualifie la Chine d’« une des principales économies les plus fermées au monde ».76 Les entreprises étrangères font état d’une « anxiété croissante » due à l’économie « lente », à un « environnement commercial restrictif » et à « l’utilisation de plus en plus agressive par le gouvernement chinois d’outils juridiques et réglementaires » contre les entreprises étrangères.76
C. L’impact du « De-risking » sur les chaînes d’approvisionnement
En réponse à ces risques géopolitiques et économiques, les entreprises mondiales mettent activement en œuvre des stratégies de « de-risking » (réduction des risques).77 Les deux stratégies dominantes sont :
- « Chine + 1 » : Maintenir la production en Chine mais diversifier une partie des nouveaux investissements vers d’autres pays comme le Vietnam, le Mexique ou la Pologne.78
- « En Chine pour la Chine » : Conserver ou étendre une base d’approvisionnement locale en Chine dans le seul but de vendre au marché intérieur chinois, tout en créant une chaîne d’approvisionnement parallèle et distincte hors-Chine pour le reste du monde.78
Cela représente une fragmentation coûteuse et inefficace des chaînes d’approvisionnement mondiales.77
La réponse politique de Pékin : Miser sur l’offre, pas sur la demande
La réponse politique de Pékin à cette crise complexe a été intentionnelle et asymétrique. Elle a rejeté la relance par la demande (comme les paiements directs aux consommateurs) et a plutôt doublé la mise sur la relance par l’offre, exacerbant les déséquilibres.
A. Politique monétaire : Paquet de 10 points et taux administrés
La PBOC a adopté une posture « convenablement accommodante ».80 Les actions clés en 2025 ont inclus :
- Paquet de 10 points (Mai 2025) : Un ensemble complet de mesures pour injecter des liquidités et restaurer la confiance.16
- Réduction du RRR (Ratio de réserves obligatoires) : Une réduction de 0,5 point de pourcentage en mai, libérant 1 000 milliards de RMB (138 milliards de dollars) de liquidités à long terme.16
- Baisses des taux directeurs : Une réduction de 0,1 point du taux de prise en pension (reverse repo) à 7 jours (à 1,4 %) et une réduction de 0,25 point des taux des « outils structurels » (par ex., refinancement pour les PME et l’agriculture).16
Cependant, ces actions ne constituent pas une relance généralisée. La plupart des mesures sont des « outils structurels » conçus pour diriger chirurgicalement les liquidités vers les secteurs des « Nouvelles forces productives » (innovation technologique, PME, consommation de services).16 Pendant ce temps, la PBOC a maintenu stables les Taux préférentiels de prêt (LPR) en septembre (1 an à 3,00 %, 5 ans à 3,50 %) 82, démontrant sa réticence à inonder de crédit le secteur immobilier. Il s’agit d’une « politique monétaire du côté de l’offre » conçue pour financer la stratégie d’investissement de la Section IV.
B. Politique budgétaire : Le gouvernement central prend le contrôle
La politique budgétaire raconte la même histoire. Les gouvernements locaux étant fiscalement paralysés (Section VI), le gouvernement central a pris le contrôle du levier d’investissement. Le budget 2025 comprend une expansion budgétaire significative, financée par l’émission de Bons du Trésor spéciaux ultra-longs (les rapports suggèrent entre 1 000 et 3 000 milliards de RMB).17
Fait crucial, ces fonds sont destinés aux « stratégies nationales importantes », à la « capacité de sécurité dans les domaines clés », à l’« innovation technologique » et à la « promotion de nouvelles forces productives ».17 Le gouvernement central contourne les LGFV défaillants et finance directement ses priorités industrielles.
C. Le déséquilibre critique de la politique
La politique monétaire et la politique budgétaire visent toutes deux massivement à financer l’offre (investissement, industrie manufacturière, haute technologie). Il n’existe presque aucune politique significative 31 visant à stimuler la demande (consommation, soutien aux ménages). C’est le pari fondamental de Xi Jinping : que l’investissement massif dans la production de haute technologie 6 créera des emplois de haute qualité, ce qui à terme stimulera la consommation.
Mais dans l’intervalle, cette stratégie aggrave le déséquilibre central de l’économie : une surproduction massive 84 et une demande intérieure faible.18 Ce choix politique est la cause première de la déflation interne de la Chine et de ses conflits commerciaux extérieurs.
Perspectives 2026 et conclusions stratégiques
L’ancien modèle de croissance de la Chine (immobilier + infrastructures financées par les LGFV) est irrévocablement brisé. Le nouveau modèle (fabrication de haute technologie + exportations, financé par le gouvernement central) est en place. Cette reconfiguration définit les perspectives pour 2026.
A. Prévisions 2026 : Consensus sur la décélération
Il existe un consensus sur le fait que l’économie chinoise continuera de ralentir, bien qu’il y ait un désaccord sur la gravité :
- Institutions multilatérales : Le FMI prévoit une croissance de 4,2 % pour 2026.85 La Banque mondiale projette une croissance de 4,2 % 86 ou 4,0 % 88, en supposant une « stabilisation progressive du secteur immobilier » 89 que notre analyse remet en question.
- Banques d’investissement : Les banques d’investissement sont plus pessimistes. UBS prévoit une décélération beaucoup plus marquée à 3,0 % pour 2026.90 Fait crucial, leurs prévisions s’alignent sur le récit déflationniste de ce rapport, prévoyant que l’IPC sera négatif en 2026, à -0,2 %.90 Morgan Stanley voit également une « sous-performance » de la Chine et s’attend à ce que l’économie lutte contre la déflation.84
Les risques penchent vers les scénarios les plus pessimistes, compte tenu de la profonde faiblesse de la demande et de l’incapacité de la politique à y remédier.
B. Risques structurels à long terme : Démographie et productivité
Le potentiel de croissance à long terme de la Chine est miné par deux forces inexorables :
- Démographie : Le « dividende démographique » s’est transformé en « fardeau démographique ».92 La population en âge de travailler a atteint son pic en 2013 92 et est maintenant en déclin rapide, tandis que la population vieillit.93
- Productivité : La croissance de la productivité, la seule autre source de croissance, ralentit.89
La stratégie des « Nouvelles forces productives » (Section IV), avec son accent obsessionnel sur la robotique 49 et l’IA 50, doit être comprise dans ce contexte. Ce n’est pas seulement une politique industrielle ; c’est une tentative désespérée d’utiliser la technologie pour générer des gains de productivité et compenser l’effondrement démographique. Le 15e Plan quinquennal (2026-2030) 94 est un pari à quitte ou double sur le fait que l’IA et les robots pourront stimuler la productivité assez rapidement pour payer les retraites d’une population vieillissante et gérer la montagne de dettes héritée du boom immobilier.
C. Conclusion stratégique : Le nouveau modèle instable de la Chine
L’économie chinoise fin 2025 n’est pas en train de s’effondrer. Elle se reconfigure en une puissance industrielle technologiquement avancée, mais structurellement déséquilibrée. Le nouveau modèle de croissance est en place, mais ses coûts sont immenses. Sur le plan interne, il génère des pressions déflationnistes, ignore le consommateur et ne résout pas la crise de la dette. Sur le plan externe, il dépend d’excédents commerciaux insoutenables qui provoquent des conflits commerciaux directs et la fragmentation de la chaîne d’approvisionnement.
L’économie chinoise montre une force immense du côté de l’offre et une fragilité dangereuse du côté de la demande. Ce paradoxe définira sa trajectoire et sa relation conflictuelle avec l’économie mondiale dans les années à venir.