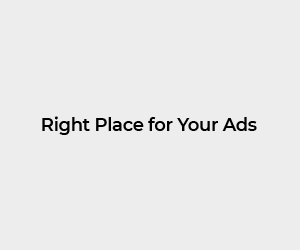Dans l’une des décisions les plus complexes et les plus attendues de l’année, la Réserve fédérale américaine (Fed) a procédé à une deuxième baisse consécutive de ses taux d’intérêt, une mesure préventive visant à soutenir un marché du travail qui montre des signes d’épuisement. Cependant, cette décision, loin de projeter la confiance, a révélé de profondes fissures idéologiques au sein de la banque centrale et a mis en lumière l’extraordinaire brouillard qui enveloppe l’économie américaine. Le Comité fédéral de l’open market (FOMC) a réduit son taux directeur de 25 points de base, le situant dans une nouvelle fourchette cible de 3,75 % à 4,00 %, son plus bas niveau depuis près de trois ans.
- Naviguer à l’aveugle : le double défi du « shutdown » et d’un marché du travail affaibli
- L’inflation persistante et le dilemme des droits de douane : l’autre facette du double mandat
- Une décision fracturée : les voix dissidentes au sein du comité de la Fed
- La fin du « Quantitative Tightening » : un changement subtil mais significatif
- Powell sur la corde raide : entre pression politique et incertitude future
- Réactions des marchés et perspectives mondiales : que signifie cette décision pour les investisseurs et les autres banques centrales?
Cette mesure n’a cependant pas fait l’unanimité. Le vote, par 10 voix contre 2, révèle une fracture importante sur l’orientation de la politique monétaire, résumant le dilemme central de la Fed : doit-elle donner la priorité à la stimulation de l’emploi, même au risque de tolérer une inflation qui reste obstinément supérieure à son objectif de 2 %?
La complexité du moment est sans précédent. Le « shutdown » partiel du gouvernement fédéral, qui approche de son premier mois, a suspendu la publication de statistiques économiques vitales, obligeant les responsables de la politique monétaire à « naviguer à l’aveugle », selon les termes de plusieurs économistes. Le président de la Fed, Jerome Powell, a reconnu que la situation était « un défi », devant trouver un équilibre entre les risques à la baisse pour l’emploi et les risques à la hausse pour l’inflation.
Simultanément, la Fed a annoncé une autre décision d’envergure : la fin de son programme de réduction de bilan (resserrement quantitatif ou QT) à partir du 1er décembre. Cette mesure, bien que de nature technique, marque un virage subtil mais sans équivoque vers une politique moins restrictive, motivée par les tensions croissantes de liquidité sur les marchés financiers.
| Indicateur | Décision / Donnée | Contexte / Implication clé |
| Taux des fonds fédéraux | Baisse de 0,25 point. Nouvelle fourchette : 3,75 % – 4,00 %. | Deuxième baisse consécutive. Vise à soutenir le marché du travail malgré une inflation élevée. |
| Vote du Comité (FOMC) | 10 voix pour, 2 contre. | Décision non unanime. Des dissidents demandaient une baisse plus importante (Miran) ou aucune (Schmid), reflétant une profonde incertitude. |
| Réduction du bilan (QT) | Prendra fin le 1er décembre. | Met un terme au resserrement quantitatif. Répond aux tensions de liquidité et normalise la politique de bilan. |
| Orientations futures (Forward Guidance) | Une baisse en décembre « n’est pas une conclusion inévitable ». | Powell tempère les attentes du marché concernant de nouvelles baisses automatiques, soulignant la dépendance aux données futures. |
Naviguer à l’aveugle : le double défi du « shutdown » et d’un marché du travail affaibli
La principale justification de la baisse des taux réside dans l’inquiétude croissante de la Fed quant à la santé du marché du travail. Dans son communiqué et lors de la conférence de presse qui a suivi, le président Powell a décrit un tableau de ralentissement progressif mais évident, qualifiant le marché de l’emploi de « moins dynamique et quelque peu affaibli » par rapport au début de l’année. Cette évaluation s’appuie sur un ralentissement de la création d’emplois et une légère hausse du taux de chômage qui, en août, dernière donnée officielle disponible, a atteint 4,3 %, son plus haut niveau depuis 2021.
Le problème fondamental pour le FOMC est que cette photographie est déjà obsolète. Le brouillard informationnel provoqué par le « shutdown » du gouvernement l’empêche d’avoir une vision claire de l’évolution récente, le Bureau of Labor Statistics (BLS) ayant suspendu ses publications. Cette situation a laissé la Fed « naviguer à l’aveugle », l’obligeant à fonder ses décisions sur des données alternatives et moins exhaustives. Powell a admis que « certaines données importantes du gouvernement fédéral ont été retardées », tout en précisant que les informations disponibles auprès de sources publiques et privées ne suggéraient pas de changement radical dans les perspectives.
Parmi ces sources alternatives, on note le rapport de la société de traitement des salaires ADP, qui indiquait une perte nette de 32 000 emplois dans le secteur privé en septembre. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un substitut parfait au rapport officiel, cette donnée a renforcé le scénario d’un ralentissement et a probablement fait pencher la balance en faveur d’une baisse. Powell a également souligné des facteurs structurels, tels qu’une immigration plus faible et une baisse du taux de participation à la population active, qui affectent l’offre de main-d’œuvre.
Cette dépendance à des données partielles a transformé le paradigme opérationnel de la Fed. Son mantra d’être une institution « dépendante des données » (data-dependent) est devenu une réalité de « privation de données » (data-deprived). L’incertitude est passée du statut de variable économique à gérer à celui d’obstacle procédural. L’analogie éloquente de Powell — « Que faites-vous si vous conduisez dans le brouillard? Vous ralentissez » — n’est pas une simple figure de style. C’est la description précise d’une crise méthodologique. Lorsque la visibilité est nulle, l’action par défaut est la prudence, ce qui fait du manque de données un argument puissant contre de nouvelles actions audacieuses en décembre. La paralysie politique à Washington a engendré une paralysie informationnelle qui menace de se traduire par une paralysie de la politique monétaire.
L’inflation persistante et le dilemme des droits de douane : l’autre facette du double mandat
Si la faiblesse du marché du travail poussait la Fed à baisser ses taux, la persistance de l’inflation exerçait une force tout aussi puissante en sens inverse. C’est là le cœur du dilemme auquel la banque centrale est confrontée, prise dans le conflit inhérent à son double mandat : promouvoir le plein emploi et maintenir la stabilité des prix.
Les données les plus récentes, qui ont pu être publiées, montrent une inflation bien supérieure à l’objectif de 2 %. L’indice des prix à la consommation (IPC) de septembre s’est établi à 3,0 % en glissement annuel, tant pour l’indice global que pour l’indice sous-jacent (qui exclut l’énergie et l’alimentation). Des composantes clés comme le logement (shelter) restent élevées, avec une augmentation annuelle de 3,6 %. L’indicateur préféré de la Fed, le déflateur des dépenses de consommation personnelle (PCE), bien que plus modéré, reste également élevé, avec une estimation de 2,8 % pour la même période. Le communiqué du FOMC reconnaît lui-même que « l’inflation a augmenté depuis le début de l’année et reste quelque peu élevée ».
Cet environnement est compliqué par un facteur exogène : la politique douanière de l’administration Trump. Powell a reconnu que les droits de douane pèsent sur les prix de certains biens. La Fed est confrontée à l’incertitude quant à savoir si cet effet sera transitoire ou persistant. Le « scénario de base » de Powell est que les droits de douane provoquent un « changement ponctuel du niveau des prix », un effet unique. Cependant, il a également admis le risque que l’impact inflationniste puisse être « plus persistant », un scénario qui nécessiterait une réponse beaucoup plus énergique.
Cette situation place la Fed devant un choix difficile. La politique monétaire traditionnelle est efficace pour combattre l’inflation par la demande, mais elle est beaucoup moins adaptée pour contrer une inflation par les coûts (cost-push), comme celle provoquée par les droits de douane. Tenter d’étouffer ce type d’inflation par des hausses de taux pourrait écraser l’activité économique sans résoudre la cause première de la hausse des prix.
La décision de baisser les taux dans ce contexte est un signal clair des priorités actuelles du comité. Elle révèle que, dans la balance des risques, le FOMC craint davantage une récession provoquée par un marché du travail en détérioration que le risque qu’une inflation de 3 % se désancre des anticipations. C’est un pari calculé : tolérer une inflation supérieure à l’objectif à court terme pour donner une bouffée d’oxygène à l’économie réelle, dans l’espoir que le choc des droits de douane soit, effectivement, temporaire.
Une décision fracturée : les voix dissidentes au sein du comité de la Fed
Le vote final de 10 contre 2 n’est pas un simple détail technique ; c’est la manifestation la plus claire du carrefour politique dans lequel se trouve la Réserve fédérale. Les deux votes dissidents représentent les pôles du débat interne et incarnent les récits opposés qui se disputent la définition de l’état de l’économie.
À l’extrême le plus accommodant (les « colombes »), on trouve Stephen Miran, un gouverneur nommé par le président Trump. Pour la deuxième réunion consécutive, Miran a voté pour une baisse de taux plus agressive, de 50 points de base. Sa position reflète la vision selon laquelle l’économie est confrontée à un risque imminent de ralentissement. Dans cette perspective, l’affaiblissement du marché du travail est le principal signal d’alarme, et la Fed agirait avec trop de timidité. Sa vision se reflète dans les projections anonymes (« dot plot ») de la Fed, où un membre (probablement Miran) préconise des taux dans une fourchette de 2,75 % à 3,00 % d’ici fin 2025, ce qui impliquerait des baisses beaucoup plus profondes.
À l’opposé, chez les « faucons », se situe Jeffrey Schmid, président de la Réserve fédérale de Kansas City, qui a voté pour le maintien des taux inchangés. Cette position représente l’orthodoxie de la lutte contre l’inflation. Pour Schmid, le principal échec de la politique monétaire est un taux d’inflation qui double l’objectif de 2 %. De ce point de vue, baisser les taux est dangereux, car cela pourrait être interprété comme un signe que la Fed cède sur son engagement en faveur de la stabilité des prix, risquant ainsi sa crédibilité anti-inflationniste.
Jerome Powell a ouvertement reconnu l’existence d’« opinions très divergentes » au sein du comité, notamment sur les mesures à prendre en décembre. Il a expliqué que les membres ont des prévisions différentes et des niveaux d’aversion au risque variés : certains sont plus réticents aux écarts par rapport à l’objectif d’inflation, tandis que d’autres le sont par rapport à l’objectif d’emploi.
Dans ce contexte, la baisse de 25 points de base n’apparaît pas comme un consensus solide, mais comme un compromis fragile. C’est la voie médiane qui cherche à répondre aux préoccupations sur l’emploi sans abandonner complètement la vigilance sur l’inflation, ce qui laisse présager que les décisions futures continueront de faire l’objet d’un débat intense.
La fin du « Quantitative Tightening » : un changement subtil mais significatif
Au-delà de la baisse des taux, la réunion d’octobre a apporté une autre décision stratégique : la fin du programme de réduction du bilan de la Fed, connu sous le nom de Quantitative Tightening (QT). À partir du 1er décembre, la banque centrale cessera de réduire activement la taille de son portefeuille d’actifs, qui avait diminué de 2 200 milliards de dollars au cours des trois dernières années et demie.
Le QT est le processus inverse du Quantitative Easing (QE) et donc une forme de resserrement monétaire. Mettre fin au QT est, par conséquent, une mesure accommodante. La justification de la Fed est purement technique, mais elle révèle des inquiétudes quant à la stabilité du système financier. Powell a expliqué que des « signes clairs » sont apparus, indiquant que les réserves bancaires passent d’un niveau « abondant » à un niveau simplement « ample ».
Ces signes de tension se sont manifestés sur les marchés monétaires, en particulier sur le marché des pensions livrées (repo), où les institutions se prêtent des liquidités à court terme. En mettant fin au QT maintenant, la Fed agit de manière préventive pour éviter une crise de liquidité comme celle de septembre 2019. Bien que passée plus inaperçue, cette décision élimine un facteur de restriction monétaire. La Fed continuera de laisser arriver à échéance ses détentions de titres adossés à des créances hypothécaires (MBS), mais réinvestira les produits dans des bons du Trésor, modifiant ainsi la composition de son bilan vers des actifs plus liquides et de plus courte durée.
Powell sur la corde raide : entre pression politique et incertitude future
La communication de la politique monétaire est presque aussi importante que la politique elle-même, et lors de la conférence de presse qui a suivi, Jerome Powell s’est livré à un délicat exercice d’équilibriste. D’une part, il a dû faire face à la pression politique persistante de la Maison-Blanche, le président Trump lui reprochant de ne pas baisser les taux plus agressivement.
Cependant, son principal défi a été de gérer les attentes des marchés. Avant la réunion, les investisseurs tablaient sur une nouvelle baisse en décembre. Conscient de cela, Powell a utilisé un langage inhabituellement ferme pour tempérer cet optimisme, déclarant qu’une nouvelle baisse « ne doit pas être considérée comme une conclusion inévitable ; en fait, elle en est loin ».
Cet avertissement a eu un effet immédiat. La probabilité d’une baisse en décembre a chuté de 85 % à près de 62 %, et des analystes comme ceux de Nomura ont révisé leurs prévisions, passant d’une attente de baisse à une anticipation de pause. Powell a insisté sur le fait que la politique monétaire « ne suit pas une trajectoire prédéfinie » et que le comité « rassemblera toutes les données possibles » avant de décider.
Ce changement de communication est une stratégie délibérée pour retrouver de la flexibilité. Dans un environnement d’incertitude extrême, avec des données contradictoires et un comité divisé, s’engager à l’avance sur une trajectoire politique est un risque trop élevé. En introduisant une dose d’ambiguïté stratégique, Powell oblige les marchés à redevenir véritablement « dépendants des données » et s’accorde une marge de manœuvre maximale pour réagir à des informations économiques qui, à ce jour, n’existent même pas.
Réactions des marchés et perspectives mondiales : que signifie cette décision pour les investisseurs et les autres banques centrales?
La réaction initiale des marchés a été ambivalente, reflétant la dualité du message. La baisse attendue était positive, mais le ton prudent de Powell sur l’avenir a déçu ceux qui espéraient un cycle d’assouplissement plus prolongé. En conséquence, l’indice du dollar s’est renforcé de 0,4 %, l’or a chuté de 1,2 % et le S&P 500 a clôturé en légère baisse de 0,3 %.
Pour les investisseurs en France et en Europe, la décision de la Fed doit être analysée dans un contexte de divergence croissante entre les principales banques centrales. Alors que la Fed a repris les baisses, ses homologues européens ont adopté une posture d’attente.
La Banque centrale européenne (BCE), lors de sa réunion d’octobre, a maintenu son taux de dépôt à 2,0 %, signalant une pause dans son cycle d’assouplissement. La présidente Christine Lagarde a indiqué que l’économie de la zone euro fait preuve de résilience et que l’inflation se stabilise, ce qui réduit l’urgence de nouvelles mesures de relance. De même, la Banque d’Angleterre (BoE) devrait maintenir ses taux à 4,0 % lors de sa prochaine réunion, alors qu’elle fait face à ses propres défis.
Cette divergence marque un tournant. Ces dernières années, le monde s’était habitué à une politique monétaire mondiale synchronisée. Aujourd’hui, ce front commun se fissure. La Fed est motivée par des préoccupations nationales concernant l’emploi ; la BCE fait une pause grâce à une inflation plus contenue ; et la BoE est confrontée à sa propre conjoncture complexe.
Ce découplage a des implications significatives pour les flux de capitaux et les marchés des changes. Une Fed plus accommodante que la BCE pourrait, à moyen terme, exercer une pression à la baisse sur le dollar par rapport à l’euro, à mesure que les différentiels de taux se resserrent. Pour les entreprises européennes, cela pourrait rendre les importations en provenance des États-Unis moins chères, tandis que pour les investisseurs français, cela affecterait la rentabilité de leurs actifs libellés en dollars.
En conclusion, la dernière décision de la Fed n’est pas seulement un événement économique américain ; c’est le signal de la fin d’une ère de politique monétaire mondiale synchronisée et le début d’un monde « à plusieurs vitesses ». Le brouillard qui enveloppe l’économie américaine n’obscurcit pas seulement la vision de Jerome Powell, mais annonce également une période de plus grande volatilité pour les investisseurs du monde entier.